
À l'occasion de la parution de son roman Les ressources naturelles, Christiane Vadnais nous offre un essai en hommage au fleuve Saint-Laurent.
***
La première fois que je l’ai vu – vraiment vu, au sens où je lui ai reconnu une existence propre –, c’était à des centaines de kilomètres de chez moi. Là où le Saint-Laurent s’appelait techniquement golfe, amoureusement mer, on pouvait s’approcher de lui, sentir son odeur brutale, et entrer en contact – comme avec une entité mystérieuse.
De cette splendeur lointaine qu’il avait été dans ma ville natale, Québec – où on se targue de la vue qu’on a sur lui –, le Saint-Laurent était ici une force animée de sa propre vie. Sur la plage de Pabos, en visite chez ma cousine, son eau était grise et froide, hérissée d’écume. Elle regorgeait d’algues sombres, de bois soyeux et de coquillages qu’on noyait dans la Javel avant de les déposer sur nos tables de chevet. Plus tard, on les collerait contre nos oreilles pour y chercher une musique déjà tue.
La Gaspésie était pleine d’altérités : d’immenses saumons veillaient au fond des fosses où on se baignait, les innombrables fous de Bassan allaient, peut-être, se jeter sur nous; et ce petit cœur de maquereau qui battait encore sur le quai après que mon oncle l’eut arraché, à la fois magnifique et effrayant, que disait-il de ma vie de citadine obsédée par les livres?
Circa 1995, je n’avais jamais rien vécu d’aussi déroutant et donc désirable que des vacances dans la baie des Chaleurs.
Les fleuves et les océans ont toujours eu pour moi la fluidité du désir, son ampleur, ses parfums emmêlés de liberté et de terreur. Plus tard, ils ont dissout mes tristesses, porté mes joies. J’ai fait l’amour pour la première fois au bord de la mer. Peut-être parce que le mouvement des vagues est le même que celui de l’inspiration, de l’expiration. Peut-être parce que c’est là que, alors qu’ils n’étaient encore que des éponges, nos plus lointains ancêtres se sont aimés à l’origine – tellement qu’ils se sont multipliés, transformés, qu’ils sont devenus autre chose. Des tétrapodes. Des baleines. Nous.
*
Je n’arrive pas à comprendre qu’on puisse qualifier le Saint-Laurent de « ressource naturelle »; que l’on considère les fleuves, les lacs, les forêts et les espèces qui y vivent comme des moyens, et non comme des fins en soi. Le mot « ressource » vient du latin surgere, « s’élever », me dit Antidote alors que j’écris ce texte; pourquoi cherchons-nous à nous élever aux dépens de ces êtres, de ces choses, plutôt que de nous hisser ensemble vers le haut?
Nous rêvons à partir de ce qui entre en nous par les sens; nous pensons avec les territoires que nous foulons, voyons, polluons, dévorons.
Quand j’ai écrit Les ressources naturelles, j’ai fait une résidence au bord du fleuve, où un scientifique m’a dit qu’il croyait que les crabes auraient déserté le Saint-Laurent d’ici 2050. J’ai lu un livre qui m’a convaincue que les baleines savaient parler et que, bientôt, nous pourrions les comprendre – à peu près au moment où nous aurions fini de détruire leurs habitats, si nous manquons à notre devoir de révolte.
Surtout, j’ai lu la philosophe Donna Haraway : « Vivre avec le trouble, en rejetant les futurismes, est une affaire à la fois plus sérieuse et plus vivifiante » que le désespoir, écrit-elle. Et ses mots m’ont donné le droit de regarder les possibles dissimulés dans les failles de ce monde abîmé, ils ont porté mon regard plus loin.
*
Je ne me suis pas baignée depuis longtemps dans les vagues glacées de Pabos. J’ai aujourd’hui d’autres voies vers le Saint-Laurent. Pourtant, je n’ai jamais oublié ma première vraie rencontre avec lui. Alors que j’écris ces mots, j’essaie de sentir son eau voyager dans mon sang, jusqu’au bout de mes doigts qui effleurent le clavier. J’ai l’impression de le voir s’évaporer dans la canicule de l’été 2025, un autre qui brûle, et composer les nuages au-dessus de ma tête; puis retomber dans la pluie, avec la poussière rouge du port de Québec, celle qui se dépose, jour après jour, le long des fenêtres de mon bureau. Où que je pose mon regard, je le cherche, une ombre derrière les livres de ma bibliothèque venus par porte-conteneur; une présence derrière chaque donnée virtuelle transmise par les câbles qui colonisent désormais les fonds sous-marins. J’écris avec le trouble, ce serait si facile de l’oublier.
Je tape « sons de tempête sur l’océan » dans la barre de recherche YouTube. J’enfile mes écouteurs. Je ferme les yeux. J’imagine non ce qui a été, non ce qui est, mais ce qui pourrait être, ici, maintenant. Les erreurs et les victoires. La violence, la douceur. Les possibles ouverts par une relation de vivante à vivants, où il n’y aurait d’autres « ressources naturelles » que l’imagination et le désir.
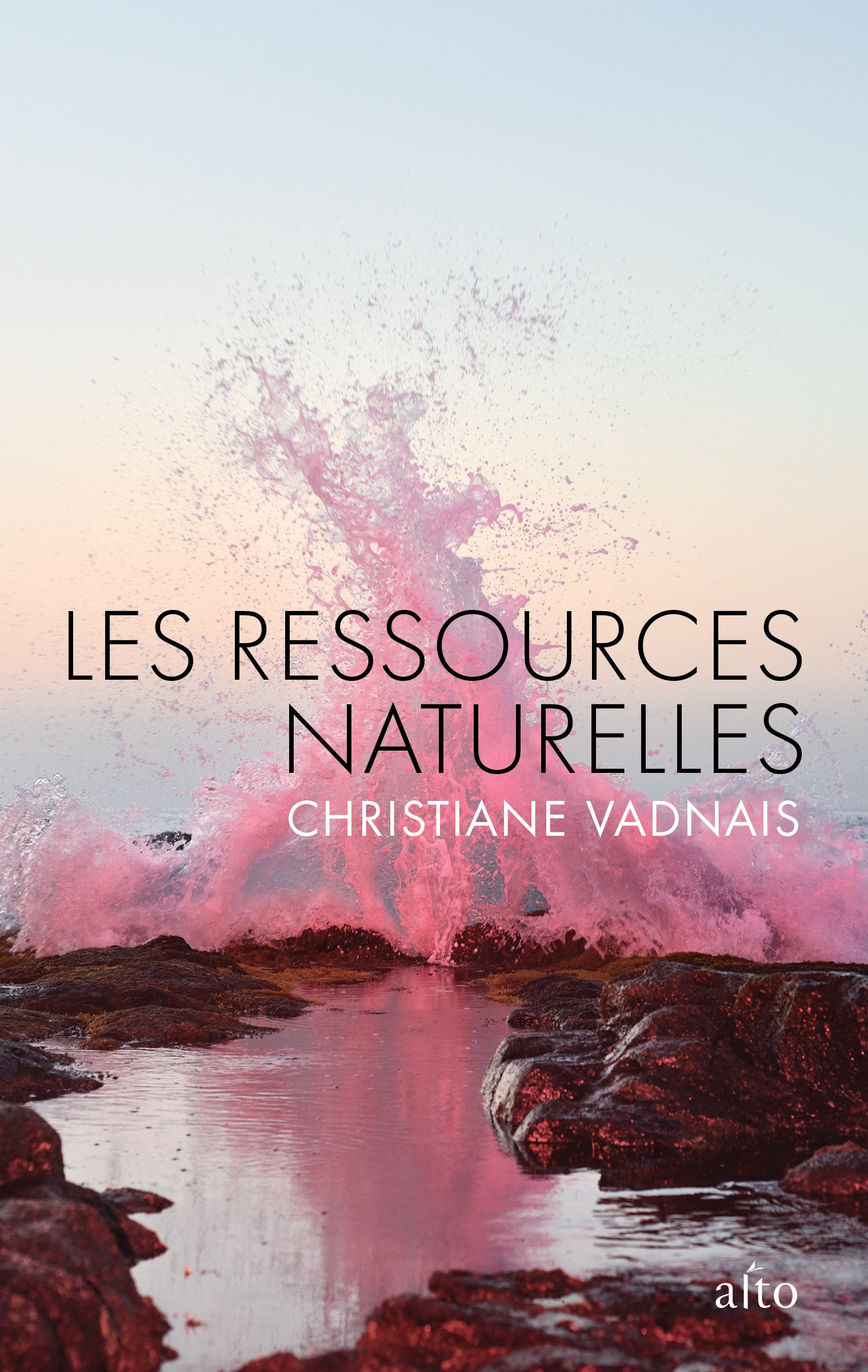
Christiane Vadnais
Les ressources naturelles
Il y a des choses qu’on croit éphémères parce qu’on les voit mourir, d’autres qu’on croit inertes parce qu’on ne les a jamais vues naître.



