
Comment faire parler des gens qui n’existent pas? Les personnages de romans doivent-ils nécessairement s’exprimer dans une langue romanesque?

Pour ma part, je n’aime pas écrire des dialogues en français littéraire. Malgré cela, je me suis astreinte à le faire dans mes deux précédents livres. Quand un récit se déroule dans plusieurs pays et idiomes différents, il faut uniformiser, me disais-je. C’est donc ce que j’ai fait dans Le mur mitoyen et Madame Victoria. Composer des répliques dans ce qu’on nomme absurdement le français «international», comme s’il existait une déclinaison neutre de la langue, débarrassée de ses «impuretés» locales, de toute trace de territoire et d’histoire, fut, sinon efficace, passablement déprimant. Ce que je gagnais en cohérence, je le perdais en rythme, en relief, en poésie et en humour.
La première dimension de L’avenir qui ait émergé : une ville désertée, reprise par une nature à la fois délicate et délirante. Des herbes échevelées profitant de la moindre fissure dans le pavé, des voitures défoncées envahies par le lierre. C’est en observant les coins les moins surveillés de Montréal que cette obsession s’est installée, mais rapidement, la ville de Detroit, dont de grands segments sont retournés à l’état sauvage ou au monde agricole, s’est imposée.
Sont ensuite venus les personnages. Gloria, la mère endeuillée qui débarque dans la maison de sa fille, puis Eunice, sa voisine bourrue et généreuse, Salomon, l’agriculteur féru d’histoire, et les enfants sauvages qui vivent en autonomie dans un boisé. Des gens qui habiteraient non seulement les lieux, mais aussi le temps de la ville, son présent, son passé et, fatalement, son futur. Dès le départ, ils étaient absolument clairs dans ma tête, comme il en va de ces protagonistes qui apparaissent tout formés, avec une personnalité complète. Mais une chose demeurait incertaine : en quelle langue ces gens allaient-ils se parler ?
Allais-je vraiment, une fois de plus, faire cet étrange compromis face à des personnages qui, en théorie, communiquent en anglais, et leur prêter un français dépouillé de tout relief pour éviter de les ancrer dans une culture qui n’est pas la leur ?
Cette question est restée en suspens, tout comme une immense part du roman à venir qui, à ce stade, était encore une forme obscure et mouvante à palper dans le noir jusqu’à ce que ses contours se révèlent. Ce sont finalement les origines de la ville, c’est-à-dire le début de la colonisation de son territoire, qui m’ont fourni à la fois la clé de voûte de mon projet et celle de la langue orale. Detroit, initialement baptisée le Fort Pontchartrain du Détroit, a été fondée par le Français ambitieux et un peu escroc qui a donné son nom à la plus légendaire des grosses bagnoles : Antoine de Lamothe Cadillac. Ce n’est qu’une soixantaine d’années plus tard que le fort est passé aux mains des Britanniques, puis, au bout de près d’un siècle, des Américains. La région est le plus ancien établissement francophone à l’ouest de Montréal.

J’ai ainsi trouvé le chemin entre mon désir d’écrire des dialogues dans un français plus vivant et le lieu physique où mon histoire cherchait à s’implanter. Il me semble étrange, aujourd’hui, de penser que c’est mon obstination à maintenir certaine forme d’oralité qui m’a conduite à ce qui, rétrospectivement, est peut-être l’idée la plus déterminante du projet, soit le recours à l’uchronie, c’est-à-dire une histoire alternative, ou contre-factuelle, bref, le fait de réécrire l’histoire de la ville de Detroit en imaginant que celle-ci ne soit jamais devenue américaine. Ce fut un de ces moments où deux idées s’entraînent mutuellement, la première construisant sur la seconde, et la seconde construisant sur la première.
J’ai vite pris conscience que ce qui constitue mon français «neutre» était tout aussi étrange dans la bouche d’Eunice ou de Fidji, la cheffe des enfants, que l’accent châtié d’une lectrice de nouvelles.
Dans les premières versions, tous les personnages avaient la même langue, celle que je connais le mieux, soit le québécois. Mais j’ai vite pris conscience que ce qui constitue mon français « neutre » était tout aussi étrange dans la bouche d’Eunice ou de Fidji, la cheffe des enfants, que l’accent châtié d’une lectrice de nouvelles. Considérant qu’il existe des différences marquées entre le français du Québec, des Maritimes, de l’Ontario et des Prairies, il m’a soudainement paru absurde d’attribuer à mes Détroitfortins le même dialecte que celui que je parle moi-même.
S’est alors amorcé un long processus que, pour rester fidèle à mes propres ressources linguistiques, je caractériserais comme du gossage. Les dialogues ont connu plusieurs formes, remaniements et microtransformations selon l’étape où en était mon exploration non seulement des déclinaisons existantes du français nord-américain, mais des possibilités d’invention.
J’ai commencé par les évidences. J’ai vécu quelques années à Toronto où j’ai côtoyé des Franco-ontariens et leurs particularités langagières, et j’avais également en tête les expressions un peu plus vieillottes utilisées par mes grands-parents paternels, tous deux originaires du village de Casselman, à une cinquantaine de kilomètres d’Ottawa. Puisque, logiquement, mon Fort-Détroit faisait partie de l’Ontario, j’ai suivi ce filon, pour conclure au bout d’un moment que ça ne marchait pas tout à fait — ces accents et ces mots n’étaient pas ceux de la francophonie sud-ontarienne ; ils relevaient surtout de l’est de la province, géographiquement et culturellement plus proche de Montréal que de la région de Windsor-Detroit. Il m’a par ailleurs semblé qu’à trop vouloir coller à la réalité, je m’affranchissais et me privais tout à la fois du défi que je m’étais lancé : imaginer une langue proprement locale, pour un lieu semi-fictif.
Sans pour autant faire table rase de ce que j’avais mis en place, j’ai amorcé une réflexion sur ce qui devait caractériser le parler des Détroitfortins. Deux suppositions en ont découlé. La première : le français de la ville aurait évolué en vase relativement clos pendant plusieurs années. Ainsi, son vocabulaire aurait conservé certains archaïsmes particuliers à cette région. La seconde idée est qu’une telle proximité avec les États-Unis aurait évidemment généré un bon nombre d’anglicismes. Je me suis donc attelée à émailler le texte d’expressions vieillies, de vocabulaire ancien, de calques de l’anglais, inventant certains mots ou détournant le sens de termes existants.

Cependant, c’est la découverte des travaux de Marcel Bénéteau qui a eu l’impact le plus important sur les dialogues de L’avenir. Cet ethnologue, lui-même issu de la région de Windsor, a consacré une grande partie de sa carrière à la documentation de l’histoire, de la culture et du folklore de la région de la rivière Détroit, mais également, et ce fut déterminant pour moi, de sa langue, publiant un lexique de plus de 500 pages recensant des milliers de mots et expressions locales. J’ai lu ce livre d’un bout à l’autre trois ou quatre fois afin de me familiariser avec les vestiges de la langue parlée par les premiers colons de la région ainsi qu’avec les termes qui, ayant traversé l’épreuve du temps, demeurent en usage dans les communautés environnantes.
J’ai intégré ces trouvailles à mes dialogues, altérant non seulement le vocabulaire de mes personnages, mais aussi leur syntaxe. Les ouvrages de M. Bénéteau m’ont en effet permis de découvrir, en plus du lexique du Détroit, les structures de phrases propres à cette région, souvent influencées par l’anglais, ou alors conservant la trace de formulations plus anciennes qui m’étaient inconnues, un peu comme un secret inscrit dans l’ADN des mots, un atavisme linguistique.
J’avais donc atteint ce que je cherchais. Une langue originale, à la fois ancrée dans le français local et détachée de celui-ci, une langue fictive qui tenait la main à la réalité, à l’image de l’histoire de mon Fort-Détroit, assise sur des faits tout en étant truffée d’inventions. Il me restait à trouver un équilibre entre l’exubérance de mon dialecte et la lisibilité. C’est au cours de ce travail de lissage, et également en faisant lire mon texte à des collaborateurs, que m’est apparu un problème majeur : j’avais appliqué l’accent de façon trop uniforme. Mes personnages parlaient à peu près tous de manière identique.
Salomon, un cultivateur érudit, avait le même niveau de langue que Francelin, un homme à tout faire peu instruit. Gloria, étrangère en sol détroitfortin, s’exprimait pourtant comme les natifs de la ville. J’ai retravaillé les répliques de chaque personnage afin de les distinguer les uns des autres, et opté, avec Gloria, pour une sorte de joual plus indéfini – indéfini parce que le village natal du personnage l’est aussi ; on ne sait jamais exactement d’où elle vient. Enfin, je me suis tournée vers les enfants.
J’avais déjà donné aux kids de la Rouge une langue un peu différente. Si le français de Fort-Détroit avait théoriquement évolué en vase clos, c’était d’autant plus vrai de celui de la communauté d’enfants isolée dans les bois. Je leur avais donc attribué des expressions particulières, et intégré les fautes courantes qu’on connait aux plus petits (je n’aurais jamais cru avoir autant de plaisir à écrire « si j’aurais », ou « ils sontaient »). À chaque nouvelle étape de travail, j’ajoutais des éléments, tentant de renforcer la spécificité de leur langue. Sans arriver exactement à ce que je voulais. Il fallait aller plus loin.

Ces personnages ont quitté leurs familles tôt, n’ont pas fréquenté l’école, et n’ont par conséquent que très peu de modèles linguistiques chez les adultes. Ils devaient forcément posséder un parler unique, fondé autant sur l’émulation que sur l’invention. Et des gamins aussi rebelles, rejetant toute norme issue du monde des adultes, devaient faire fi des règles de grammaire. J’ai donc poussé un peu plus loin leur vocabulaire, créant des néologismes là où j’imaginais qu’il pouvait y avoir eu des trous dans leur apprentissage. Mais le plus grand remaniement s’est s’est opéré dans la conjugaison.
L’avenir est, entre autres, un livre sur le temps. Celui qu’on ne peut rattraper, sur lequel on n’a plus aucun pouvoir, et celui qui nous attend, sur lequel on peut encore exercer une influence. J’ai voulu explorer la façon dont passé et futur s’articulent et proposer, notamment en ayant recours à une certaine forme de surnaturel, un renversement de la linéarité qui gouverne notre conception du temps. Dans la version définitive du roman, les enfants de la Rouge utilisent les temps de verbes de manière aléatoire – un trait qui se retrouve dans une moindre mesure chez la plupart des enfants (pensez seulement à l’usage systématique de l’imparfait chez l’enfant qui joue) –, intervertissant le passé, le présent, le conditionnel et le futur, trahissant ainsi à la fois leur mépris des règles grammaticales, mais aussi leur incapacité à s’inscrire dans une logique temporelle standard. Cette résistance à la chronologie est très forte chez les orphelins de Fort-Détroit, qui refusent de grandir et dont l’existence est soumise à un temps plus cyclique.
J’ai en outre fait le choix de débarrasser leur langue de la plupart des anglicismes qui teintent celle de leurs ainés, jouant sur l’idée selon laquelle le français nord-américain se dégraderait de plus en plus et se laisserait, à chaque génération, pénétrer davantage par l’anglais. Défiant cette évolution qui paraît presque inévitable aux yeux de certains, mes petits rebelles font exactement le contraire.
Au bout de tout ce chemin, je ne suis toujours pas certaine d’avoir trouvé l’équilibre idéal entre les différentes sources qui sont entrées en jeu dans l’élaboration des niveaux de langue qui traversent mon roman. J’ai l’impression très nette que, chaque fois que je relirai un dialogue, j’aurai encore envie d’y changer un adjectif, d’inventer un verbe, de m’approprier un dicton anglais ou de détourner une structure de phrase. Les langues sont, par définition, mouvantes ; elles ne peuvent tolérer d’être encarcanées, empêchées d’aller où elles veulent par des académiciens ou des chroniqueurs puristes, tout comme les villes, avec leur béton et leur paysagement psychorigide, ne peuvent empêcher les fleurs sauvages de croître dans les fissures du trottoir. C’est peut-être pour ça qu’il m’est difficile de fixer définitivement mon français détroitfortin.
Je crois à tout le moins avoir satisfait mon désir initial. Mes personnages parlent une langue musicale, mordante et drôle. Une langue que j’espère digne de la résilience des vrais habitants de la région : les Franco-ontariens, qui ont vécu des années difficiles, notamment depuis l’élection d’un gouvernement qui veut affaiblir leurs droits linguistiques, et les citoyens de Detroit, qui ont tenu leurs quartiers et communautés à bout de bras pendant que la ville traversait les pires épreuves. Une langue hybride, que les archevêques du français qualifieraient certainement de bâtarde et de dégradée. Mais à mes yeux, ce sont les créoles, les slangs et dialectes mixtes qui représentent ce que le langage comporte de plus créatif, luxuriant et libre. Et c’est cette liberté qui, bien plus que les codes qui fossilisent nos idiomes, assure la survie des langues, et perpétue leur magie.
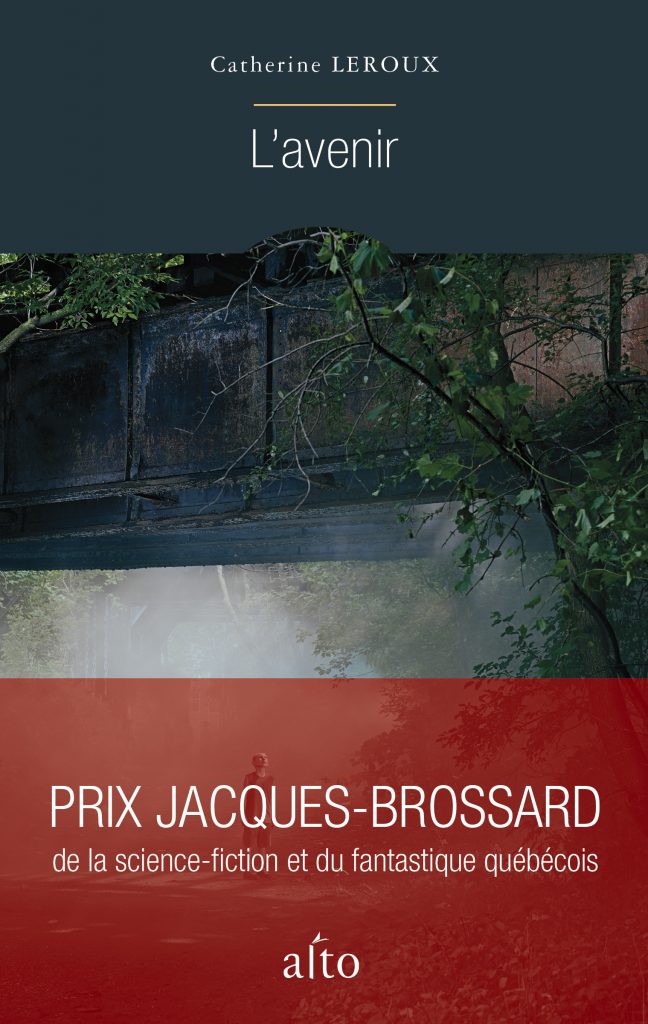
Catherine LEROUX
L'avenir
Ils sont les rivières qui ne sont jamais les mêmes. Ils sont la lumière d’étoiles éteintes depuis mille ans. Ils sont la lueur de la lune qui n’est que le reflet d’autre chose. Bientôt, elle le sait, ils partiront – ils ne lui ont jamais appartenu. Les bébés sont des êtres transitoires, leur proximité, une fiction.



