
MORT NUMÉRO UN
J’ai six ans. C’est un matin d’automne. En compagnie de mon ami Sylvain, je marche sur Grand Boulevard en direction de notre école qui porte un nom de pape. Nous parlons probablement de son nouveau vélo motocross rouge rutilant qu’il accepte de me prêter même si mes wheelies laissent à désirer, ou peut-être que nous commentons en détail une cascade d’Evel Knievel ou encore le dernier épisode de The Dukes of Hazzard, notre autre passion du moment. Je ne me souviens plus comment il atterrit devant nous, une électrocution ou une rencontre tragique avec une voiture, mais l’écureuil est là : sa petite carcasse ensanglantée frétille sur l’asphalte, sa queue bat l’air, parcourue sur toute sa longueur de spasmes que nous prenons pour des décharges électriques. Une odeur de cuir brûlé se mêle à celle des feuilles mortes. Pendant un instant, on se demande si un écureuil électrocuté peut exploser et prendre en feu, c’est que nous ne connaissons que les morts spectaculaires. Puis, plus rien, la petite bête se raidit, du sang coagule dans le pelage gris. Nous planifions de récupérer l’animal à midi, de lui creuser une tombe à l’ombre des plants de rhubarbe qui poussent dans ma cour, de lui gosser au canif une croix de bois quand nous aurons un peu de temps devant nous. Sur le chemin du retour, nous manquons finalement de courage et détournons la tête, pressés d’aller manger.
MORT NUMÉRO DEUX
J’ai sept ans. C’est le cours de catéchèse. À la demande de Blandine, nous déplaçons nos petites chaises pour former un cercle. Maxime prend la parole et raconte que son grand-père est mort la veille. Nous le regardons avec des airs graves. L’enseignante demande si le grand-père était malade. Maxime répond: « Il est mort sur la bolle, en forçant. » Un garçon s’esclaffe. L’enseignante lui fait de gros yeux. Puis, un autre enfant se met à rire très fort, bientôt suivi par Maxime et le reste de la classe. Le fou rire est généralisé, incontrôlable, jubilatoire. Même Blandine craque et finit par rire aux larmes.
Quelques semaines plus tard, le père de mon amie Johanne meurt. C’était mon amie la plus ricaneuse, elle avait des fossettes spectaculaires et dans ses yeux brillaient en permanence des lueurs dorées de feux de Bengale. À sa fête d’anniversaire, elle m’avait appris à danser le pied de poule, à ne pas avoir peur de vraiment beaucoup bouger les fesses en signe de détresse.
Le jour des funérailles, toute la classe est invitée à l’église. Nerveux, incapables de tenir en place pendant la cérémonie, nous faisons claquer les agenouilloirs, et rejouons la scène du fou rire, mais, cette fois, c’est un désastre. Le curé nous foudroie du regard, aucun adulte ne rit avec nous. Nous comprenons alors qu’il y a des décès qui sont plus crève-cœur que d’autres.
MORT NUMÉRO TROIS
J’ai huit ans. C’est un Vendredi saint. Je m’en souviens parce que je suis en train de regarder Jésus de Nazareth quand le téléphone sonne. J’apprends, pendant la scène de la résurrection, qu’une amie de la famille, Irène, est morte. Je suis en plein dans ma « période chrétienne », qui durera quelques mois tout au plus, marquée notamment par une crise mémorable dans un Woolco pour que ma mère m’achète une Bible illustrée. C’est l’année de ma première communion et recevoir le corps du Christ me fait grand effet. Je donne à la mort d’Irène des allures mystiques.
Au salon funéraire, j’observe le corps blême constellé de taches de rousseur, une perruque a remplacé ses longs cheveux roux. Il flotte une odeur de poudre pour bébés et de fleurs mortuaires autour du visage figé d’Irène, décédée à même pas trente ans d’une leucémie. C’est le premier cadavre humain que je vois. Mon père me demande si je veux toucher les mains jointes d’Irène, au fond du cercueil, pour lui dire adieu. J’avance la main, en petite fille obéissante et curieuse. Je m’étonne de trouver la chair froide, rigide.
MORT NUMÉRO QUATRE
J’ai onze ans. C’est l’heure du lunch. Je m’arrête au Perrette pour acheter je ne sais quoi. Derrière son comptoir, le propriétaire du dépanneur regarde CNN. Je vois une fusée à l’écran, j’entends « And lift off! », suivi d’applaudissements et de conversations radio entrecoupées de friture. Soixante-treize secondes plus tard, au moment où je tends ma poignée de monnaie au-dessus du comptoir, la navette Challenger se transforme en boule de feu. C’est le silence à la télévision. Deux traînées blanches forment un Y dans le ciel de Floride, puis de minces lignes de fumée descendent en zigzags vers l’océan, traçant un étrange dessin cotonneux sur fond bleu.
Je rentre chez moi et je me prépare une soupe en sachet, je n’arrête pas de penser que je viens de voir mourir des gens en direct, en un claquement de doigts. J’ai l’appétit coupé, et je me sens extrêmement seule face à ma soupe poulet et nouilles.
MORT NUMÉRO CINQ
J’ai douze ans. C’est quelques mois après avoir déménagé dans une nouvelle maison. Je me lie d’amitié avec une gang de gars qui habitent dans ma rue. Ils font du skateboard et du BMX, pas mal de mauvais coups et, moi, je fais de mon mieux pour m’intégrer et leur cacher mon passé de première de classe. L’un d’eux vient de perdre sa mère. Les autres m’expliquent que sa grosse Oldsmobile a raté une courbe du pont Jacques-Cartier, puis ils poursuivent avec des regards sous-entendus: « C’est peut-être pas un accident, si tu vois ce qu’on veut dire. » J’imagine la voiture qui plonge dans le fleuve par un soir d’hiver.
Quatre ans plus tard, j’apprends à conduire. Alors que je roule sur le pont Jacques-Cartier, le moniteur commente: « Ralentis, la courbe de la mort s’en vient. » Encore à ce jour, chaque fois que je passe sur ce segment du pont, même si la courbe a été adoucie depuis, je pense à cette femme que je n’ai pas connue, je me dis qu’il suffit d’une sombre seconde pour céder à l’impulsion de braquer violemment le volant et d’enfoncer l’accélérateur.
MORT NUMÉRO SIX
J’ai quinze ans. C’est le cours d’anglais enrichi, en troisième secondaire. Notre prof met Shakespeare au programme, en nous disant qu’il ne faut pas avoir peur de la littérature. Elle nous lit à voix haute Macbeth avec emphase. Nous nous passionnons tous, même les joueurs de hockey de la classe, pour le roi d’Écosse. Puis, nous apprenons que l’examen de lecture sera un texte troué qui implique de savoir sur le bout des doigts les répliques clés en anglais élisabéthain. Cette semaine-là, mon unique grand-père, que je connais peu, meurt à quatre-vingt-quatre ans. Les funérailles ont lieu à Arthabaska précisément le jour de l’examen de lecture, et cela fait mon affaire. Je n’ai aucun souvenir de ces funérailles, je me demande même si j’y ai vraiment assisté, mais je me souviens encore de certaines répliques de Macbeth apprises par cœur: Is this a dagger which I see before me, the handle toward my hand? Come, let me clutch thee. I have thee not, and yet I see thee still.
MORT NUMÉRO SEPT
J’ai vingt-sept ans. C’est l’hiver. Dans le stationnement de l’Hôpital Notre-Dame, la neige est sale. Je viens d’apprendre coup sur coup que je suis enceinte, que je fais une fausse couche et que mon père a le cancer.
Je retombe enceinte rapidement. Mon père dépérit à mesure que mon ventre grossit, mais il s’accroche, il veut connaître mon bébé. À l’automne, il entre dans une maison de dernier repos pour malades en phase terminale dont le pronostic est inférieur à trois mois. J’en suis au dernier trimestre de ma grossesse. À quelques jours de ma date prévue d’accouchement, il me dit «je t’aime» pour la première fois de sa vie, du fond de son lit, et cela ressemble à un adieu. Je pleure en rentrant chez moi, j’ai peur de ne pas accoucher à temps pour le voir mourir grand-père.
Ma fille naît en décembre, un peu avant le soixante-quatrième anniversaire de mon père. Ma sœur vient me chercher à ma sortie de la maison de naissance. On roule en silence sur la 20 avec, sur le siège arrière, mon bébé qui n’a que quelques heures. Mon père nous attend avec ma mère, il a voulu sortir du lit, s’est assis près de la fenêtre, a troqué son pyjama pour des vêtements désormais trop amples pour son corps émacié, s’est rasé avec soin pour prendre sa petite-fille dans ses bras.
Après, l’état de mon père se détériore rapidement. Deux jours avant Noël, on sait que c’est une question d’heures. Ses frères et ses sœurs ont fait la route depuis les Bois-Francs pour venir à son chevet. Nous sommes tous là. La morphine s’écoule. Je m’absente quelques minutes pour aller allaiter mon bébé dans une petite salle tranquille au sous-sol. Je suis en train de mettre ma fille au sein, j’ai un peu de mal avec la position « football » que la sage-femme m’a montrée pour prévenir les engorgements, quand ma cousine vient me chercher en courant. Je n’ai pas le temps d’agrafer mon soutien-gorge d’allaitement, nous dévalons le corridor où on entend râler des gens qui délirent. Au moment d’entrer dans la chambre, tous les visages se tournent vers moi: «Il t’attendait…» Je comprends que j’arrive quelques secondes après son dernier souffle. Mon corps se glace. Je me recueille un moment, je suis soulagée que sa souffrance ait pris fin, puis j’entends mon bébé âgé de quelques jours hurler depuis le sous-sol, réclamant la fin de sa tétée. Un immense rond de lait se forme sur mon chemisier. En parcourant pour une dernière fois ce corridor qui sent la mort, je me dis que la vie continue.
MORT NUMÉRO HUIT
J’ai trente et un ans. C’est un jour d’août très chaud. Je fais les cent pas dans le couloir de l’Hôpital général juif. Mon fils a trois mois, il dort dans la poussette. Je fixe avec nervosité la porte derrière laquelle ma belle-mère est en train de mourir. Je suis venue sans prévenir, je n’ose pas entrer avec mon bébé. La porte finit par s’ouvrir, son mari sort en larmes, suivi de ses deux fils. Sur le seuil, j’aperçois son corps sous perfusion, la maladie et la mort ont altéré ses traits, et je ressens un profond chagrin. Je marche vers le lit avec mon bébé pressé contre moi, je fais mes adieux, je suis triste à l’idée que mon fils ne connaîtra pas cette femme extraordinaire, sa bobe, comme on dit en yiddish.
Le soir, je rentre chez moi avec dans un sac de papier brun une veste en ratine de velours rose pâle imprégnée du parfum de cette femme flamboyante qui était, encore quelques semaines auparavant, une grand-mère pimpante, folle de ses petits-enfants. Je ne sais pas pourquoi j’ai dit oui quand on m’a proposé de garder les derniers vêtements qu’elle portait en entrant à l’hôpital. Je sais que je serai incapable de les porter. Je les range sur une tablette, je me dis que peut-être un jour ma fille voudra les voir.
MORT NUMÉRO NEUF
J’ai trente-quatre ans. C’est l’été. Il est minuit quatorze. Je suis assise dans le lobby d’un grand hôtel, en Espagne. Je tape les mots suivants dans un courriel que j’envoie à mes amies: «Nous sommes à Valence et rentrons à Barcelone dimanche. Je suis ébranlée parce qu’une femme s’est suicidée sous mes yeux tout à l’heure. J’ai été la dernière personne à lui parler. J’ai la désagréable impression de ne pas avoir eu la présence d’esprit d’agir comme la situation l’exigeait.» Je résume la scène: «Elle est venue me voir le poignet en sang, après s’être ouvert les veines, elle voulait que je surveille son sac. Elle m’a dit merci, puis elle a sauté du troisième étage.»
Quelques jours plus tard, dans un autre courriel, j’analyse ma réaction: «J’étais incapable de décoder ce qui se passait, dérangée par la vibe malsaine de cette femme. Je lui ai offert mon aide qu’elle a refusée, puis tout est allé très vite. Je me revois complètement engluée, ne sachant pas quoi faire, avec pour seul instinct de ne pas faire de remous, attendant que ça passe comme s’il s’agissait d’un hold-up ou d’une prise d’otages. J’essaie de ne pas m’en vouloir, et c’est difficile, mais il est important pour moi de comprendre ma réaction qui est beaucoup liée, je le vois clairement maintenant, à la présence des enfants. J’ai préféré écouter mon instinct de mère qui sent le danger plutôt que de faire une analyse efficace de la situation.»
Mes amies sont bouleversées, elles ont les mots pour me réconforter. L’une d’elles me répond que j’arriverai peut-être à sublimer le tragique de cette situation par l’écriture. Je préfère d’abord ne plus y penser et taire cette histoire qui finira par me tenailler au point de devenir, quelques années plus tard, le point de départ d’un premier roman sur ce qui nous rend fragiles, sur le désir de rester en mouvement: La femme de Valence.
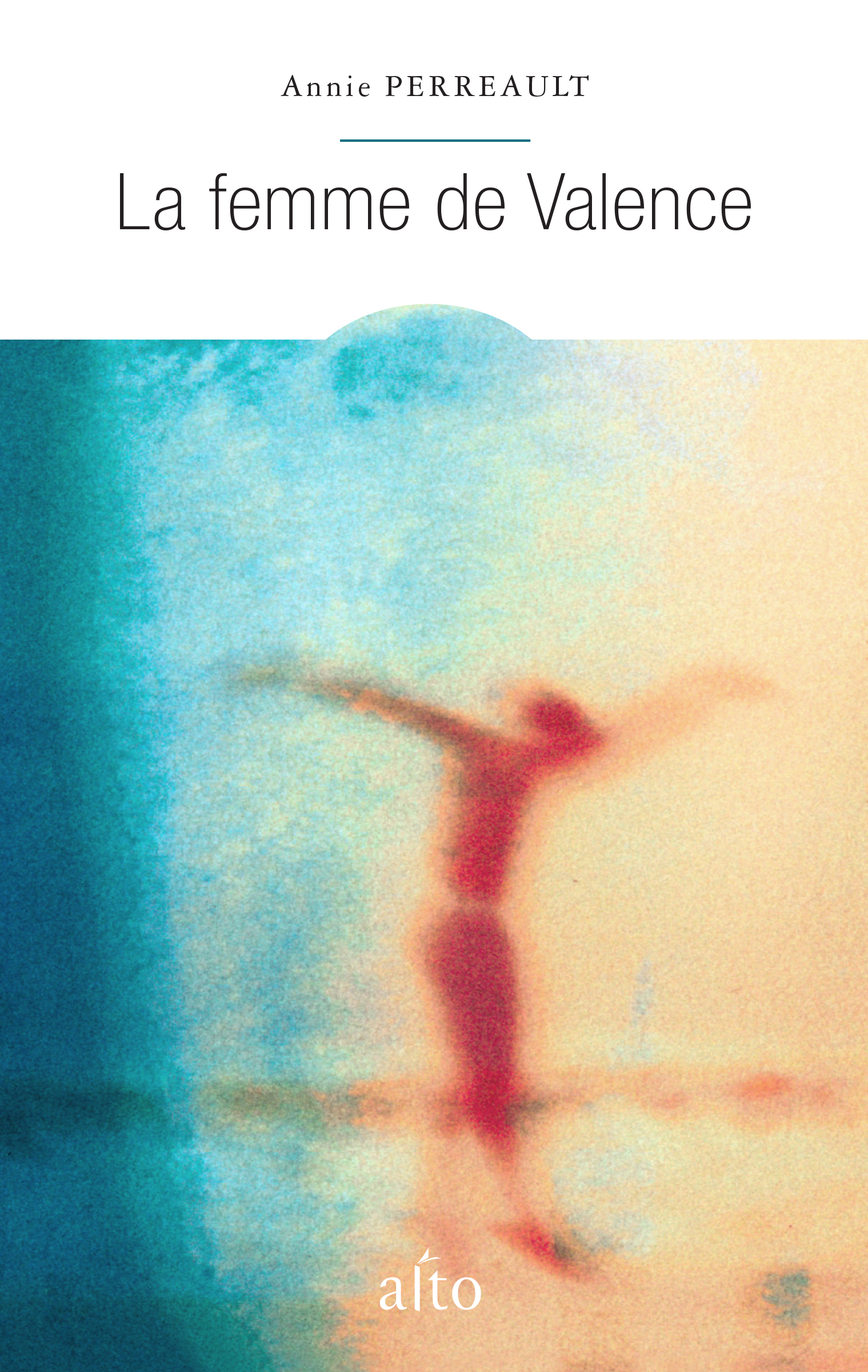
Annie PERREAULT
La femme de Valence
Tomber de haut est le plus commun des rêves.



